
Après avoir déclenché une vive contestation pendant plus d’un an au sein de la communauté universitaire et scientifique, le projet de loi de programmation de la recherche (LPR) a été définitivement adopté par le Sénat vendredi 20 novembre, après le vote favorable de l’Assemblée nationale. Mais le groupe socialiste-écologique et républicain, opposé au texte, a d’ores et déjà annoncé vouloir saisir le Conseil constitutionnel. De nouvelles manifestations rassemblant chercheurs et enseignants-chercheurs ont encore eu lieu mardi 24 novembre dans une quinzaine de villes et d’autres actions sont prévues en décembre.
Divers points suscitent en effet la colère et l’inquiétude au sein de la communauté éducative. Le premier porte sur la forme. « Aucun de nos appels à la concertation n’a été entendu. Le projet de loi a été discuté en procédure accélérée au moment de la rentrée universitaire alors que nous étions submergés par la mise en place de l’enseignement à distance. En profitant du contexte sanitaire et sécuritaire, des amendements majeurs ont été introduits dans la nuit du 28 octobre, après l’annonce du second confinement », déplore Anne-Thida Norodom, professeure de droit public à l’Université de Paris et secrétaire générale de la Société française pour le droit international.
Davantage de moyens ?
Ensuite et surtout, le fond pose problème. Cette loi, portée par la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, doit permettre d’améliorer le financement de la recherche publique et l’attractivité de ses métiers pour les années 2021 à 2030. Le gouvernement a pour objectif de consacrer au moins 3% du PIB aux activités de recherche et développement (de 2006 à 2017 il était de 2,19% en France). Pour cela, la loi prévoit d’investir 25 milliards d’euros sur les dix prochaines années au profit des organismes de recherche, universités et établissements, et d’atteindre un budget annuel de 20 milliards d’euros en 2030, soit 5 milliards de plus qu’actuellement. Mais « ce grand espoir, devenu grande déception, est désormais une grande inquiétude » a déclaré la sénatrice Sylvie Robert lors de son intervention au Sénat le 20 novembre. Selon elle, la loi aggrave les failles auxquelles elle était supposée remédier. « Elle n’est pas la loi attendue consacrant réellement et immédiatement des moyens beaucoup plus substantiels aux universités et aux laboratoires. Elle n’est pas la loi attendue endiguant le mouvement de précarisation de la recherche », a déclaré la sénatrice. Un constat partagé par SNPTES (Syndicat National des Personnels Titulaires et contractuels de l’éducation nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la recherche et de la culture) dans son communiqué du 24 novembre : « En prenant la décision de repousser largement les moyens humains et budgétaires sur les dernières années d’application de la loi de programmation, le gouvernement prend le risque, notamment en cas d’alternance ou en cas de crise budgétaire, de voir les futurs moyens budgétaires se réduire à peau de chagrin. »
Une précarisation de la profession
La communauté éducative s’inquiète également de la précarisation et de l’atrophie des emplois de l’enseignement supérieur et de la recherche. La loi prévoit, en effet, une nouvelle voie de recrutement par le biais de contrats de pré-titularisation, « les chaires de professeurs juniors », pour les directeurs de recherche et les professeurs des universités.
Un contrat à durée indéterminée de mission scientifique voit également le jour afin de recruter des personnels pour réaliser des projets ou opérations de recherche. Cependant, ce « CDI » de droit public prend fin à l’issue du projet ou de l’opération de recherche. « On va recourir à des contrats au lieu de recruter des titulaires alors que le nombre d’étudiants lui augmente. Un doctorant, après dix ans d’études, aura droit à un contrat sans aucune assurance d’être titularisé. La recherche et l’enseignement ont besoin de recrutements pérennes », rétorque Anne-Thilda Norodom.
Un contournement du CNU mal perçu
La loi de programmation de la recherche accorde la possibilité jusqu’en 2024 de « déroger à la qualification des maîtres de conférences par le Conseil national des Universités (CNU) ». Or c’est cette instance nationale qui autorise les titulaires d’un doctorat à enseigner, qui est le garant indépendant de la qualité scientifique des candidats, et qui protège contre localisme et clientélisme. Cette expérimentation passe mal. « Les expérimentations finissent souvent pas être pérennisées. Frédérique Vidal a dit devant l’Assemblée nationale que celle-ci ferait l’objet d’une évaluation par l’Hcérès (Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, Ndlr), or il se trouve que le président nouvellement nommé (Thierry Coulhon, Ndlr) est un ancien conseiller d’Emmanuel Macron. On peut douter de la sincérité de cette évaluation. Et puis, il existe certes déjà des recrutements hors CNU qui ne posent pas de problèmes mais on n’enseigne pas et on ne recrute pas de la même manière au Collège de France, au CNAM, à l’EHESS, en astronomie ou en physique. En droit, par exemple, comme dans d’autres disciplines, le CNU est indispensable », ajoute la professeure de droit public.
Une atteinte à la liberté de la recherche
La communauté éducative s’inquiète également de l’orientation croissante du financement de la recherche en fonction des priorités du gouvernement. Une orientation qui passerait par le développement d’appels à projets au détriment des budgets récurrents. « En tant que responsable de deux formations et ayant deux autres responsabilités administratives, je n’ai pas de soutien administratif. Je n’ai clairement pas le temps d’assumer ces tâches, d’enseigner, de faire de la recherche et de répondre à des appels à projets. On applique à l’université ce qu’on a fait à l’hôpital… Il est normal que l’Etat puisse mettre de l’argent sur les priorités publiques mais répondre à ces appels d’offres demande énormément de temps et la recherche sera moins indépendante. Il est important de faire confiance aux chercheurs. Quand on a 10 ou 20 ans d’expérience, on peut anticiper davantage qu’un politicien les sujets qui auront de l’importance demain. Si nous répondons tous aux mêmes appels à projets, nous chercherons tous dans le même domaine or la recherche se nourrit de la diversité des travaux », plaide Anne-Thida Norodom. La recherche française en serait alors appauvrie.
Un délit d’intrusion qui n’a pas sa place
Enfin, un autre point suscite l’incompréhension : la création d’un délit de « trouble à la tranquillité et au bon ordre des établissements » qui sanctionne les intrusions dans les universités. Commises en réunion, celles-ci peuvent entraîner 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende. Un article qui surprend la communauté éducative qui ne voit pas le lien avec cette loi de programmation de la recherche. « Pourquoi créer un délit spécifique à l’université ? Les instruments juridiques existent déjà. Cette disposition s’apparente à un cavalier législatif. L’occupation des universités, c’est compliqué à gérer, mais les universités restent des lieux de liberté d’expression », ajoute la professeure de droit.
Désormais étudiants et professionnels de l’éducation espèrent que le Conseil constitutionnel censurera les dispositions qu’ils estiment les plus critiquables. En attendant, toutes les sections du CNU ont annoncé suspendre leurs travaux. « Nous, les juristes, avons la réputation d’être plutôt conservateurs et de manifester rarement. Si l’on s’implique à ce point, c’est qu’il y a vraiment un danger pour l’enseignement supérieur et la recherche », conclut Anne-Thida Norodom.










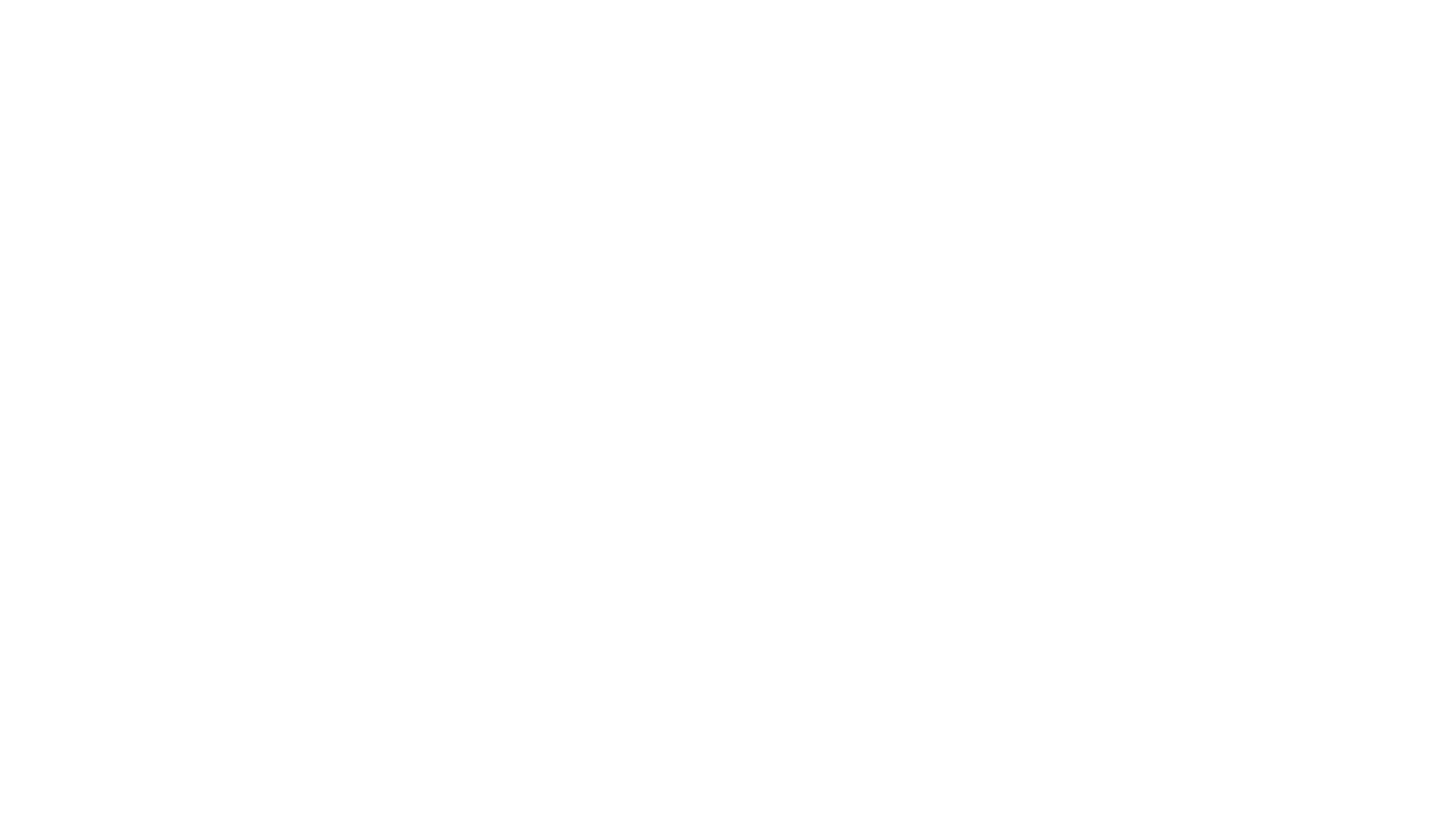



Modération par la rédaction de VousNousIls. Conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit adressez-vous à CASDEN Banque Populaire – VousNousIls.fr 1 bis rue Jean Wiener – Champs-sur-Marne 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2.