
Lancés à la rentrée 2025, les programmes EVAR et EVARS visent à généraliser une éducation à la vie affective et relationnelle à tous les élèves, de la maternelle au lycée. Objectif affiché : mieux prévenir les violences, lutter contre les discriminations et accompagner les jeunes dans leur développement. Depuis 2001 la loi prévoit trois séances annuelles obligatoires. Pourtant, d’après un rapport de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, en 2021, moins de 15 % des élèves en bénéficiaient réellement. Le ministère espère aujourd’hui déployer le dispositif grâce à un programme national détaillé par niveau, diffusé sur son site.
EVAR : apprendre à se connaître et à respecter l’autre
À l’école primaire, l’EVAR aborde le corps, les émotions, l’intimité, le respect, les stéréotypes ou encore la prévention des violences. En CM1, les élèves découvrent par exemple les changements liés à la puberté ou analysent des situations fictives de harcèlement. « L’enjeu est de ne pas stigmatiser mais aussi de ne pas encourager certaines pratiques en public (la main dans la culotte pour les filles par exemple). De même qu’il y a besoin de rappeler que si un.e camarade refuse un bisou, d’être touché.e ou vu.e aux toilettes (pas genrées ni fermées au cycle 1), il est important de respecter cela », estime Nathalie Destin, ancienne professeure des écoles.
Mais certains, à l’image de Christian Flavigny, psychiatre et psychanalyste, contestent la pertinence de ces séances à l’école élémentaire : « On parle d’éducation affective alors que les enfants sont dans leur période de latence, plus calme après le complexe d’œdipe, pour apprendre les fondamentaux. Ce sont des préoccupations d’adultes, pas d’enfants. » Une lecture que réfute Héloïse Junier, docteure en psychologie de l’enfant et autrice du livre « Le manuel de survie des parents » (Dunod), rappelant que ces concepts relèvent de la psychanalyse freudienne. « Ils n’ont aujourd’hui plus aucune valeur explicative scientifique. Les recherches montrent que les apprentissages cognitifs, émotionnels et relationnels sont profondément interdépendants. »
EVARS dans le second degré
Dans le 2nd degré, on parle d’Éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité (EVARS). Le programme s’articule autour de la sexualité et la santé (reproduction, contraception, prévention des infections sexuellement transmissibles, amour, plaisir), la lutte contre les discriminations, la prévention des violences sexuelles… Sur son site, le ministère détaille les programmes par niveau. Les 4ème, par exemple, peuvent analyser « des extraits de fictions adaptées à leur âge et des documents scientifiques pédagogiques » ou bien encore étudier ou représenter « une scène de rencontre amoureuse (en littérature, au cinéma ou au théâtre) pour réfléchir aux notions de consentement, d’exploitation sexuelle, d’emprise ou de harcèlement etc ». En 3ème, ils découvrent le cadre juridique de l’IVG et les critères d’une relation saine…
L’association Juristes pour l’Enfance soutient la nécessité d’une éducation sur ces thématiques au sein des établissements scolaires. « La complexité du monde contemporain, l’exposition précoce à des contenus sexuels amènent à devoir délivrer une information objective, fiable et ouvrir un lieu de discussion », déclare Olivia Sarton, directrice juridique de l’association.
Un dispositif de prévention
Pour Héloïse Junier, l’école n’est pas qu’un lieu d’apprentissages scolaires mais aussi un espace de socialisation. Elle accompagne les enfants dans leurs relations aux pairs et les aide à développer leurs habiletés sociales. Aborder le corps, le consentement, les limites à ne pas franchir, « ne sexualise pas les enfants mais leur apporte des repères fiables et protecteurs. Le développement affectif et sexuel commence dès l’enfance », indique-t-elle. Ces programmes assurent donc une prévention nécessaire dès tout-petit. « Il n’y a pas d’âge pour parler de sécurité à nos enfants, de droit à l’intimité, avec des mots adaptés », confirme Gaia Jami, doula et maman. D’autres voix regrettent cependant que les programmes ne tiennent pas davantage compte des écarts de développement des enfants au sein des classes. « Chacun doit être respecté dans son rythme. Le dispositif ne respecte justement pas le consentement des enfants à entendre telle information ou non », réagit Olivia Sarton, qui préférerait un accès plus modulable aux contenus.
Les interdits négligés au profit du consentement
Pour l’association qu’elle représente, le programme accorde une place excessive au consentement (même s’il ne concerne pas l’aspect sexuel dans EVAR) au détriment de l’interdit. Selon la juriste, cela peut créer de la confusion dans l’esprit des enfants. « Les agresseurs arrachent un consentement apparent des plus jeunes de manière douce. Les enfants peuvent alors se sentir responsables de ce qui leur arrive. Il faut leur dire clairement que ces actes sont interdits par la loi », clame la juriste. Elle ajoute que chez les adolescents, la gestion des pulsions ne peut pas reposer uniquement sur le consentement. Il faut leur apprendre à s’empêcher.
L’identité de genre, un sujet sensible
Le contexte inquiète aussi certains parents. « Les programmes EVARS ont été relancés dans un contexte marqué par une forte influence des idéologies woke en France. Cela n’incite pas à la confiance, d’autant plus que les termes « genre » et « identité de genre » y sont très présents », confie Catherine Delhoume, enseignante-chercheure en sociologie et maman d’une petite fille de 4 ans. Et même si le ministère de l’Éducation s’est défendu de vouloir parler de consentement sexuel à la fin du primaire, qu’il se veut rassurant sur le terme « identité de genre« , elle reste convaincue que la première version de ce projet « laissait une place plus importante à ces théories dans des versions bien plus radicales ».
Aborder le sujet de l’identité de genre avec les collégiens et lycéens inquiète également la juriste Olivia Sarton : « présenter le changement de genre comme un simple choix banalise un parcours lourd physiquement et psychologiquement ».
Qui enseigne ces programmes ?
Ces séances peuvent être dispensées par les enseignants eux-mêmes, l’infirmière de l’établissement, des intervenants extérieurs… Le recours à ce tiers permet d’informer quand le sujet est peut-être tabou à la maison. « Quand c’est l’enseignant qui anime la séance, c’est rassurant car les élèves le connaissent mais ça peut aussi les gêner d’aborder des sujets délicats avec lui car ils le voient tous les jours. A mon sens, plus il y a d’adultes formés et sensibilisés mieux c’est afin d’apporter des approches complémentaires », estime Sarah Mingant, animatrice EVARS pour une association dans le Finistère. Si Catherine Delhoume reconnaît qu’« un réel effort de transparence » a été fait par le ministère de l’Éducation, elle craint des dérives idéologiques. Elle se souvient notamment d’un article paru dans le Figaro le 17 septembre 2025, où la présidente de SOS Homophobie et professeure de lettres classiques, appelait à « tricher » et s’affranchir de la neutralité politique que doivent respecter les professeurs, considérant qu’on « peut aller plus loin » que l’EVARS. Cela fait craindre à Catherine Delhoume l’imposition de nouvelles normes anthropologiques sans le consentement des parents.
Gaia Jami, elle, se souvient qu’un professeur remplaçant avait abordé ces sujets, de sa propre initiative, de manière déplacée, dans l’école de sa fille, ce qui lui avait valu un signalement.
Éducation à la vie affective et sexuelle, le rôle de l’école ?
Le pédopsychiatre Christian Flavigny estime que l’école outrepasse sa mission. «Ce n’est pas son rôle de précéder les questions des enfants. Ce sont des thèmes qui touchent à leur identité. C’est aux parents d’y répondre car leur parole est entendable par l’enfant. » Selon lui, l’intervention d’un tiers peut, en effet, troubler la construction psychique, d’autant plus que « le milieu collectif et mixte de la classe n’est pas propice » pour ces sujets intimes. A contrario, pour Héloïse Junier, ce n’est pas l’intervention d’un adulte extérieur à la famille qui peut troubler l’enfant mais un cadre mal posé ou un discours inadapté à l’âge. « L’écrasante majorité des violences sexuelles ont lieu dans le cercle familial de l’enfant, ce type de violences représentant une moyenne de 3 enfants par classe. Est-ce vraiment raisonnable de confier à la seule sphère familiale l’apprentissage du consentement chez l’enfant ? », interroge la psychologue. Les opposants voient aussi dans ces séances une disqualification des parents à remplir leur rôle et l’obligation pour les enfants de compenser ces manquements en apprenant à se protéger eux-mêmes. La juriste Olivia Sarton alerte sur la mise à l’écart des parents : « On avance l’idée qu’ils seraient dangereux ou défaillants, alors que c’est minoritaire. Ils ont surtout besoin d’être aidés et impliqués. » Elle propose par exemple « des demi-journées parents-enfants, à l’école, pour aborder la puberté ou les pulsions sexuelles dans un climat de confiance ». Le débat reste ouvert…










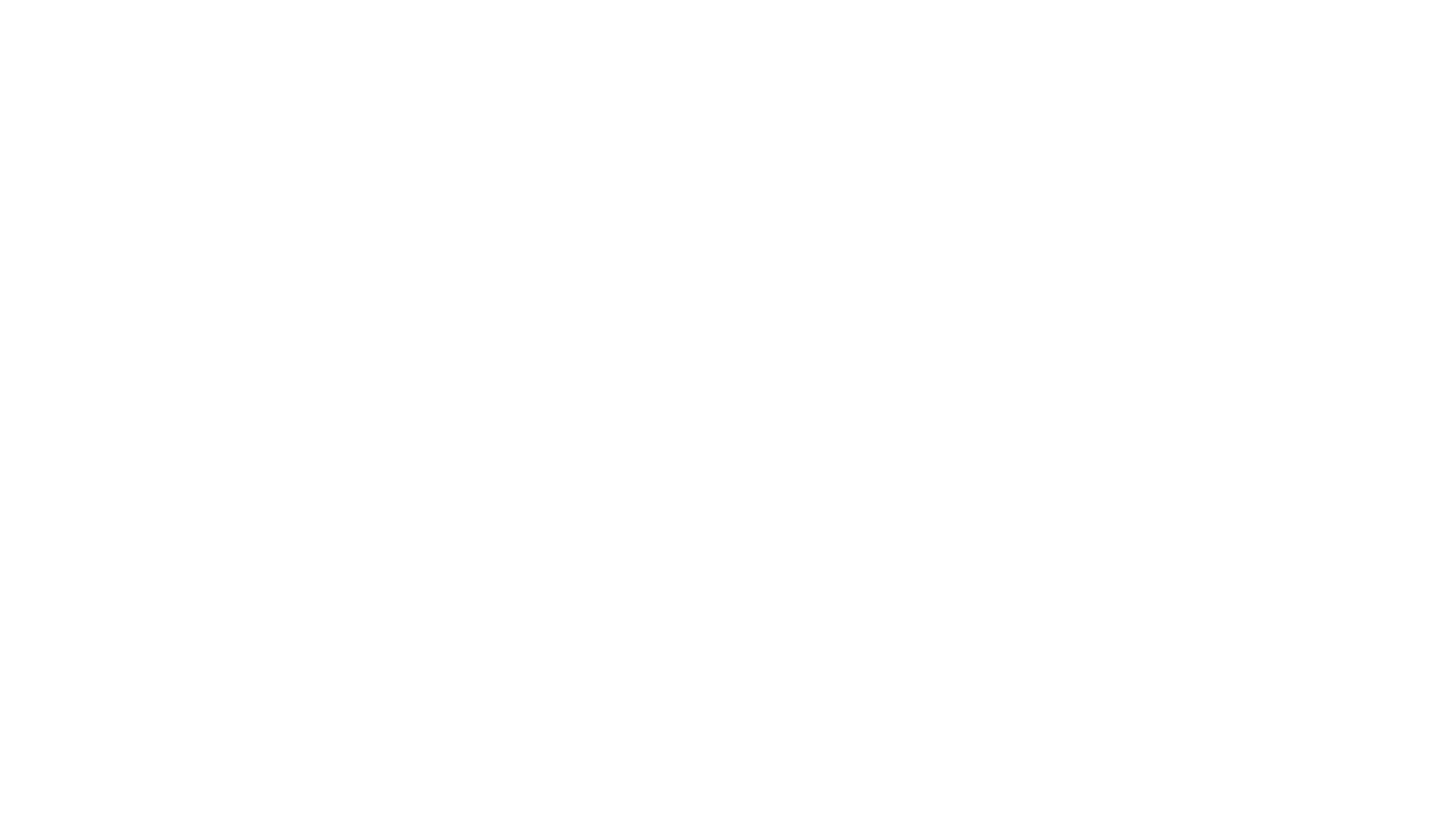



Modération par la rédaction de VousNousIls. Conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit adressez-vous à CASDEN Banque Populaire – VousNousIls.fr 1 bis rue Jean Wiener – Champs-sur-Marne 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2.