
Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer ce qui vous a conduit à enseigner en section internationale ?
Je n’ai pas un profil type. Beaucoup de collègues professeurs d’histoire-géographie en section internationale sont en réalité des natifs anglais, écossais ou américains. Dès ma deuxième année d’enseignement, j’ai passé la certification DNL (discipline non linguistique) pour enseigner ma matière en anglais. Pour être honnête, c’était pour moi un moyen d’obtenir plus vite un poste fixe : les sections européennes et internationales recrutent sur profil. Grâce à la DNL, je n’ai été remplaçant qu’une seule année. J’ai également fait ce choix en raison de mon parcours universitaire : j’ai suivi deux « summer schools » aux États-Unis lorsque j’étais étudiant, ce qui m’a donné le goût d’une approche anglo-saxonne de l’histoire.
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre lycée et le parcours international qu’il propose ?
Depuis cinq ans, le lycée Fulbert où j’enseigne à Chartres propose des sections européennes. Quand le ministère a réformé les anciennes OIB (options internationales du baccalauréat) pour créer le Bac français international (BFI), notre établissement, considéré comme un « lycée des langues », a candidaté et obtenu l’ouverture. J’étais d’abord en poste en section européenne, puis j’ai rejoint le BFI et cette année, nous sommes montés en puissance avec le lancement d’une classe de seconde internationale américaine.
Enseigner en section internationale, qu’est-ce que cela change pour vous ?
Beaucoup de choses. Les élèves ont une heure de cours d’histoire-géo en plus (4 heures au lieu de 3), avec moitié en français, moitié en anglais. Mais en pratique, les trois quarts de mon temps de cours sont en anglais car l’épreuve finale du bac est dans cette langue. Il faut jongler en permanence entre français et anglais, ce qui demande un effort supplémentaire.
Les effectifs sont réduits, autour de 24 élèves au lieu de 35, ce qui est confortable pour travailler. Les programmes, eux, sont spécifiques : ils sont élaborés en concertation entre le ministère français et, pour notre filière américaine, le College Board. Les élèves passent donc des épreuves différentes de celles du bac général, avec un oral et un écrit en histoire-géo, ce qui redonne du poids à la discipline.
L’oral, en particulier, est exigeant ?
Oui. L’élève tire au sort un sujet, en histoire ou en géographie, et présente une composition. Puis, il y a une partie entretien où l’élève répond à des questions sur d’autres chapitres. S’il a eu histoire pour la composition, il aura des questions sur la géographie. Cela évite toute impasse.
Concrètement, votre quotidien est-il très différent de celui d’un professeur d’histoire-géo en lycée général ?
Oui et non. Les classes plus petites permettent d’avoir moins de copies mais comme les élèves écrivent beaucoup et en anglais, cela reste plus long à corriger. La préparation de cours est plus lourde : il faut construire davantage d’activités interactives, laisser les élèves prendre la parole et s’inspirer des méthodes anglo-saxonnes. Je travaille beaucoup avec mes collègues, notamment d’anglais, pour croiser nos programmes. Par exemple, sur la ville et les espaces ruraux aux États-Unis, nous abordons le même thème mais sous des angles différents. Cela permet des ponts utiles pour les élèves.
Les élèves sont sélectionnés sur dossier ?
Exactement. À la fin de la troisième, ils passent des entretiens et des tests de langue. Ceux qui intègrent la seconde internationale ont un passage quasi automatique en première BFI, mais il est aussi possible d’intégrer la section seulement en première. Notre BFI est trilingue : anglais obligatoire, plus allemand ou espagnol. Cela demande un profil rare, avec un niveau solide en langues et dans les autres matières, car cela représente environ 5 heures de cours supplémentaires par semaine.
Leurs projets d’orientation sont-ils déjà très ciblés ?
Pas forcément. Au début, on pensait attirer surtout des élèves qui aiment les langues, et finalement ce n’est pas tant le cas. En fait, les élèves de BFI n’ont pas le droit de prendre une spécialité de langue. On a donc plutôt des profils scientifiques (maths, physique-chimie, SVT) ou de type Sciences Po (histoire-géopolitique, SES) qui souhaitent donner une coloration internationale à leur parcours. Dans notre première promo de bacheliers l’an dernier, les onze élèves se sont orientés vers des prépas littéraires, des écoles d’ingénieurs, Sciences Po, LEA, double licence… C’est très varié.
Menez-vous des projets particuliers avec vos classes ?
Oui, plusieurs. Nous participons par exemple au programme « Adopt a Diplomat » avec l’ambassade des États-Unis : des diplomates viennent rencontrer les élèves au lycée, et nous avons été invités à l’ambassade. Nous organisons aussi des voyages. L’an dernier, nous sommes allés à Londres, plus abordable que les États-Unis. Les élèves ont également des correspondants américains avec qui ils échangent des lettres. Il y a régulièrement des sorties à Paris, pour l’histoire des arts notamment, ou encore à l’Assemblée nationale. Ce sont souvent des projets valorisés par l’établissement, car la section internationale est un peu sa vitrine.
En ce moment, nous réfléchissons à un projet autour des 250 ans de la Déclaration d’indépendance américaine.



![[Portrait vidéo] Prof d'EPS : Un mot pour les jeunes qui souhaiteraient faire votre métier ? "N'espérez pas être payés beaucoup !" PROF EPS](https://www.vousnousils.fr/wp-content/uploads/2025/03/PROF-EPS.jpg)
![[Portrait vidéo] Prof des écoles à La Réunion : "Ici, on a la chance d’être encore dans des environnements bienveillants vis-à-vis de l’école" maxresdefault](https://www.vousnousils.fr/wp-content/uploads/2026/02/maxresdefault-1-150x150.jpg)





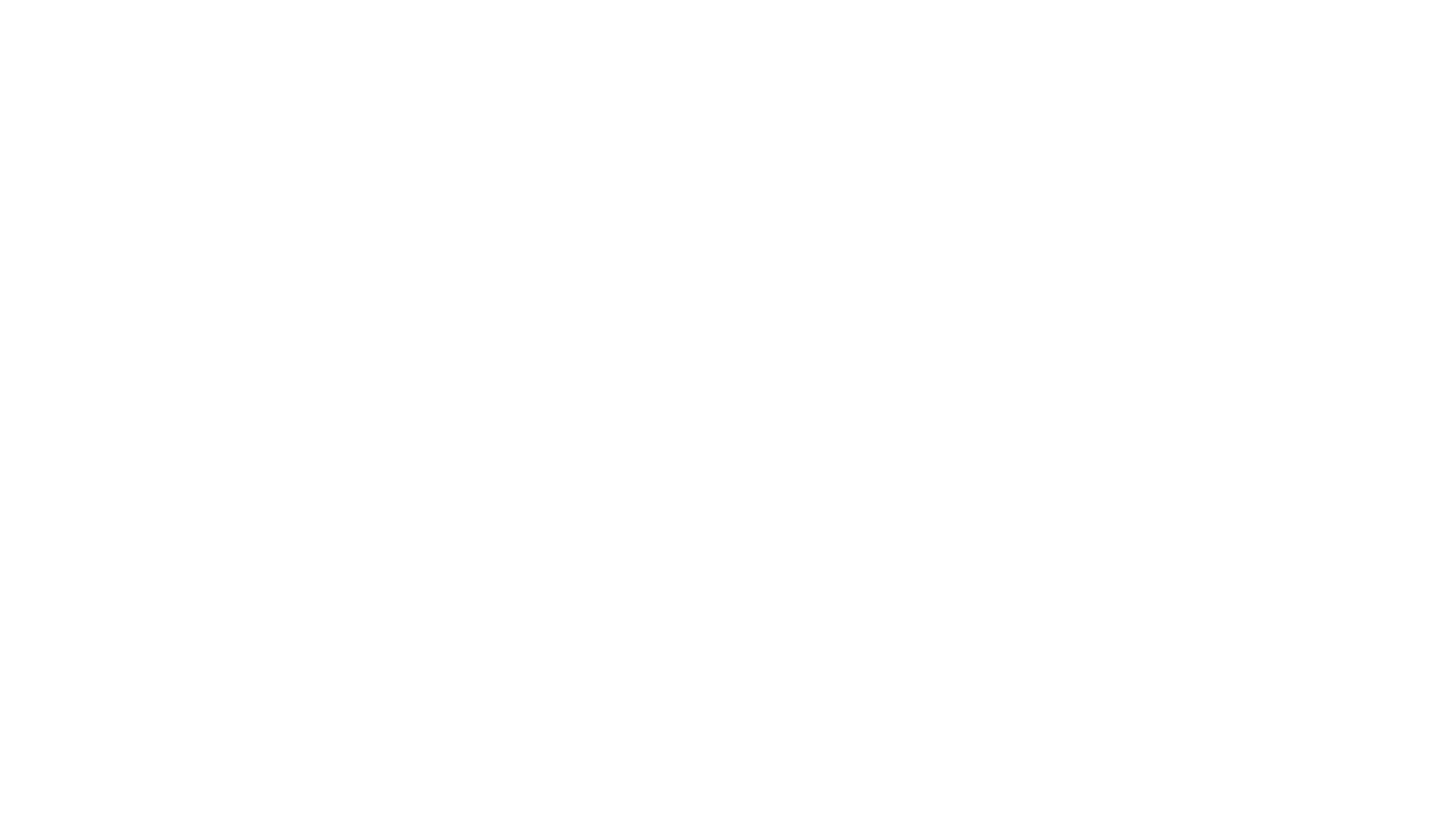



Modération par la rédaction de VousNousIls. Conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit adressez-vous à CASDEN Banque Populaire – VousNousIls.fr 1 bis rue Jean Wiener – Champs-sur-Marne 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2.